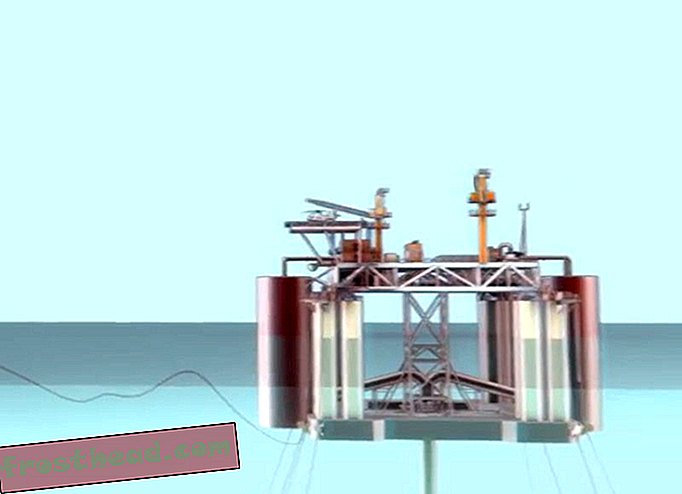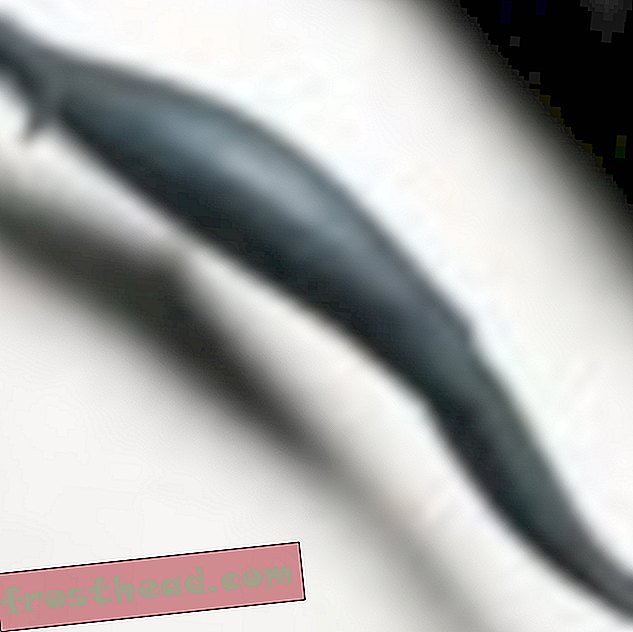Pour préserver un paysage naturel, expulsez les gens. C'était la philosophie qui a guidé les écologistes américains à la fin du XIXe siècle, lorsqu'ils ont créé les premiers parcs nationaux. Ce modèle de conservation est enchâssé dans la loi américaine de 1964 sur la nature sauvage, qui définissait la nature sauvage comme «une zone où la terre et sa communauté de vie ne sont pas gênées par l'homme, où l'homme lui-même est un visiteur qui ne reste pas». n'a qu'à visiter les paysages non peuplés de parcs maintenant réputés comme Yellowstone ou Yosemite.
Contenu connexe
- Comment l'échec du traité de paix conclu par la Colombie pourrait avoir un effet dévastateur sur ses écosystèmes riches en diversité
- Mots-clés de la science et des langues autochtones Pueden Aliarse Para Proteger Los Bosques y el Clima
- Comment les scientifiques et les groupes autochtones peuvent faire équipe pour protéger les forêts et le climat
- Comment le changement climatique transformera les animaux et plantes emblématiques des parcs nationaux
- Comment un groupe autochtone se bat pour la construction du canal du Nicaragua
Selon Andrew Davis, chercheur à Prisma, une organisation basée à San Salvador, ce paradigme de la conservation, fondé sur «des armes à feu et des barrières», repose sur une limitation radicale de ce que les habitants d'une région peuvent faire, voire la déplacer complètement. Et cela s'est répandu dans le monde entier: au cours des dernières décennies, les environnementalistes alarmés par la déforestation tropicale se sont fortement appuyés sur le «modèle Yellowstone» pour convaincre les gouvernements de restreindre les activités humaines dans les forêts restantes afin de les préserver.
Mais dans de nombreux cas, cette philosophie peut être erronée, affirment un choeur croissant d'experts.
Dans les pays du monde entier, les forêts sont restées intactes précisément parce que les communautés autochtones les géraient depuis longtemps avec efficacité. Ces communautés exploitent et récoltent souvent du bois à petite échelle, mais excluent les entreprises commerciales et les acteurs illégaux. En créant des zones soi-disant protégées, les gouvernements et les ONG ont souvent remplacé ces structures de gouvernance autochtones par des régimes d'application faibles ou inexistants, qui permettent aux agriculteurs et aux exploitants forestiers potentiellement destructeurs de s'installer.
«C’est quelque chose que vous voyez tout le temps», déclare Davis. "Vous atterrissez dans un aéroport et vous voyez des bannières géantes pour une zone protégée, les bureaux ont de beaux camions et de beaux ordinateurs, et vous vous rendez sur le territoire sans aucune présence."
Davis a exposé la situation le mois dernier à Mexico, lors d'un rassemblement de dirigeants de tout le Mexique et de l'Amérique centrale pour discuter de la publication d'un rapport récent co-rédigé par Davis. Le rapport détaille une série d’études de cas dans lesquels des communautés disposant de droits fonciers solides ont des forêts protégées, ce que les gouvernements et les organisations de protection de la nature n’ont pas réussi à faire. Les auteurs appellent à une nouvelle approche de la préservation des forêts mésoaméricaines, fondée sur le renforcement des droits des personnes qui y vivent.
Les représentants de la communauté avaient chacun une histoire unique, mais ils partageaient un thème commun: les forêts qui appartenaient à leur peuple depuis des générations avaient été transformées en zones protégées gérées par le gouvernement - et les conséquences pour les forêts et leurs habitants étaient dévastatrices.
 Dans la réserve de biosphère du papillon monarque au Mexique, l'insecte indigène le plus apprécié des États-Unis fait face aux menaces des bûcherons et des producteurs d'avocats. (Fabrizio Proietto / Alamy)
Dans la réserve de biosphère du papillon monarque au Mexique, l'insecte indigène le plus apprécié des États-Unis fait face aux menaces des bûcherons et des producteurs d'avocats. (Fabrizio Proietto / Alamy) Au Honduras, par exemple, les communautés indigènes Miskitu se sont trouvées incapables d'empêcher les éleveurs de bétail et les agriculteurs de défricher des forêts qu'ils protégeaient depuis longtemps. Après avoir créé la réserve de la biosphère Río Plátano dans les années 1980 et 1990, le gouvernement a remplacé les conseils de protection des forêts traditionnels par de nouvelles institutions moins efficaces permettant aux étrangers de s'installer.
"Les États créent des zones protégées sans prendre en compte l'existence de peuples autochtones", a déclaré Norvin Goff, président de l'organisation Miskitu, MASTA. "Ils mettent en œuvre des politiques destinées à la" conservation "afin de prendre nos ressources naturelles."
Au Guatemala, les communautés mayas Q'eqchi ont découvert Semuc Champey, un site sacré placé sous la direction du gouvernement après l’explosion de sa popularité parmi les touristes. Après le conflit entre les communautés et l'agence guatémaltèque qui a éclaté plus tôt cette année, les anciens de la communauté ont déclaré qu'ils ne pouvaient même pas accéder au site, qui comprend une série de flaques d'eau turquoise irisées. Plusieurs ont été arrêtés.
«Ils ne nous ont jamais consultés. C'est pour cette raison que nous voyons une violation de nos droits en tant que communautés autochtones », a déclaré Crisanto Tec, un ancien de la tribu Q'eqchi de la communauté d'environ 600 familles de Chicanuz. "Nous avons été les seuls à protéger la région."
Dans le même temps, les communautés de la réserve de la biosphère du papillon monarque au Mexique doivent faire face à des restrictions quant à la récolte, même en petite quantité, de bois provenant de forêts qu'elles ont habitées depuis longtemps. Pourtant, les bûcherons et, plus récemment, les producteurs d’avocats ont envahi les forêts de sapins et de pins abritant l’insecte indigène le plus apprécié d’Amérique du Nord. "D'une part, vous avez un système qui interdit aux personnes d'utiliser leurs ressources", a déclaré Gustavo Sánchez, directeur du Red Mocaf, une organisation à but non lucratif basée à Mexico. "D'autre part, vous avez des gouvernements qui n'ont pas l'argent nécessaire pour investir dans la protection de ces zones."
Face à la crise d'extinction mondiale en cours et à la présence de 80% de la biodiversité mondiale dans les territoires autochtones, les auteurs soutiennent que ces études de cas conduisent à une conclusion décisive. «C'est la région où vous avez le plus de droits reconnus: 65% des forêts de la Méso-Amérique ont été reconnues par les peuples et les communautés autochtones», a déclaré Davis. «Il existe des preuves solides dans toute la région qui démontrent qu’il existe une solution immédiatement disponible pour faire face à la crise de la perte de biodiversité.»
Dans certains cas, des groupes autochtones et communautaires ont pu faire marche arrière. Les communautés forestières de la réserve de la biosphère Maya dans la région de Petén, dans le nord du Guatemala, ont joué un rôle déterminant pour convaincre le gouvernement d'autoriser une exploitation forestière durable à partir de 1994, par exemple. Les communautés autochtones Guna de l'est du Panama gèrent avec succès une zone forestière et marine depuis des décennies. Et au Honduras, les communautés de Miskitu ont récemment acquis des titres sur des terres ancestrales, mais il est trop tôt pour dire quel impact cela aura sur la forêt.
Des organisations internationales telles que l'Union internationale pour la conservation de la nature et la Convention sur la diversité biologique ont également entériné la gestion des forêts autochtones et communautaires ces dernières années. Ce sont des étapes positives, dit Davis. Mais il ajoute qu’ils n’ont pas encore abouti à des gains concrets pour la plupart des communautés.
À l'exception de quelques cas isolés, «des progrès ont été réalisés dans les cadres, mais ce que vous ne voyez pas, ce sont des progrès sur le terrain», dit-il. «La discussion autour des peuples autochtones est un acteur passif dans la lutte pour la préservation de la biodiversité et non un protagoniste.»
Le rapport Prisma n'a pas été revu par des pairs, et on ne sait pas exactement comment les études de cas ont été choisies ni dans quelle mesure leur échantillon est représentatif, note Janis Alcorn, directrice principale de la Rights and Resources Initiative à Washington, DC. Des études montrent clairement que «malgré les progrès réalisés, il reste encore beaucoup à faire».
Des articles de la littérature universitaire ont également démontré que les peuples autochtones peuvent protéger les forêts au moins aussi efficacement que les gouvernements. Des études menées au Brésil et au Panama ont montré que les zones protégées et la gestion autochtone dépassaient les systèmes de gestion des terres pour éviter la déforestation, à l'instar d'une analyse réalisée en 2014 de plus de 100 études examinées par des pairs.
Certains défenseurs, cependant, soutiennent que les communautés ont besoin de plus que de simples droits fonciers. La structure de gouvernance, le soutien financier et l'accès aux capitaux et aux marchés peuvent tous aider à déterminer si une communauté peut protéger ses forêts contre les menaces extérieures, déclare Benjamin Hodgdon de Rainforest Alliance, basé à New York, qui a constaté que les concessions forestières guatémaltèques ont connu une baisse considérable taux de déforestation puis des zones environnantes.
«Si vous cédez des forêts à des communautés qui sont incitées à les conserver et qui ont le droit de récolter et de vendre du bois et d’autres produits forestiers et qui ont une culture de moyens de subsistance basés sur la forêt, cela peut être une approche plus efficace pour conserver la forêt est plus traditionnelle que la protection stricte », déclare Hodgdon. "Mais ne prétendons pas que le simple fait de céder la terre va faire l'affaire."
Les dirigeants de la communauté ont souligné qu'ils luttaient pour les droits depuis longtemps et ne s'attendaient pas à gagner du jour au lendemain. «Espérons que dans 30 ou 40 ans, nous ne serons pas ici. Mais jusque-là, nous continuerons à travailler dur pour les générations futures », a déclaré Levi Sucre Romero, dirigeant de RIBCA, organisation de groupes autochtones du Costa Rica et président de l'Alliance mésoaméricaine des peuples et des forêts basée à Managua, Nicaragua.
Cela dit, a ajouté Romero, une chose a changé sans équivoque pour le mieux. «Bien souvent, nos droits ont été violés et personne n'a rien dit», a-t-il déclaré. "Ce n'est plus le cas."