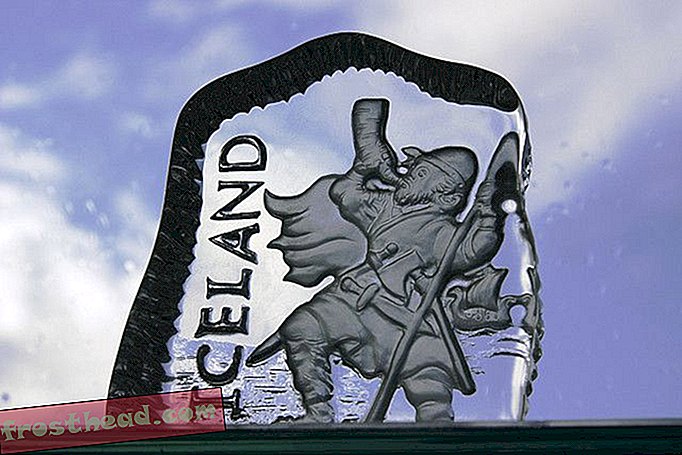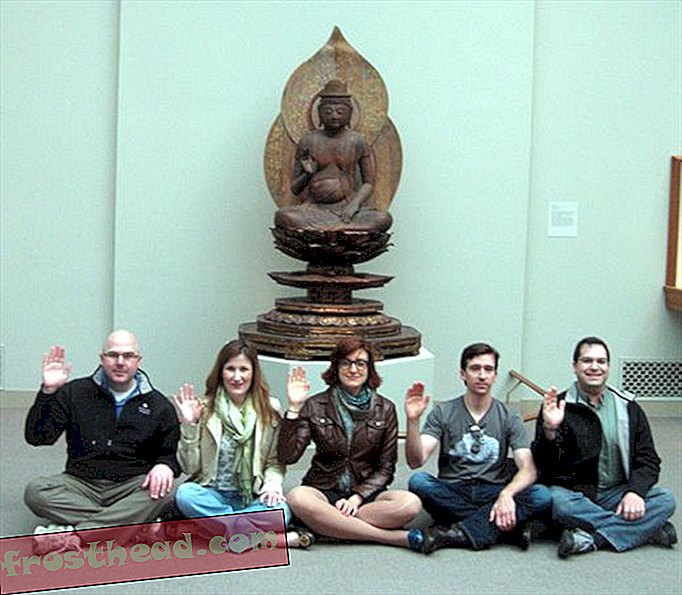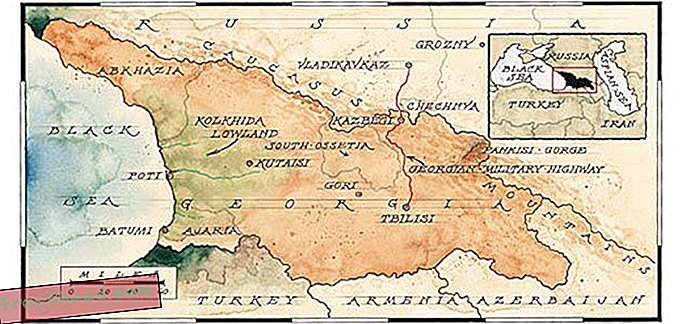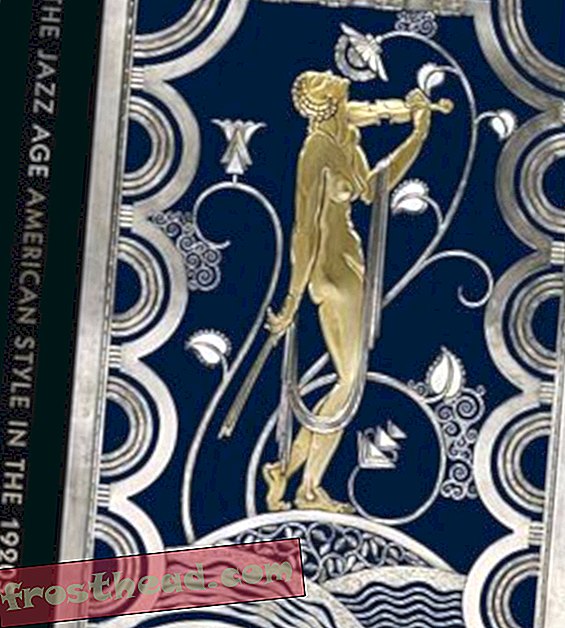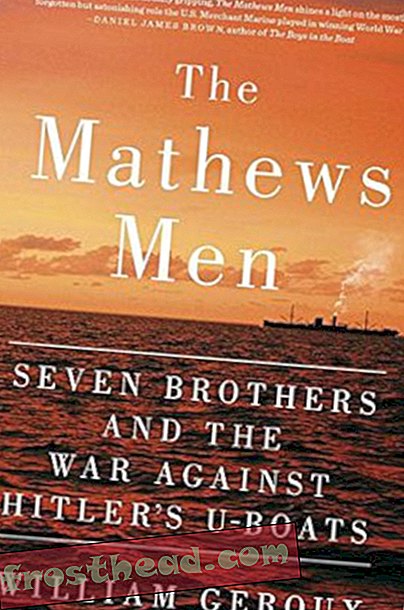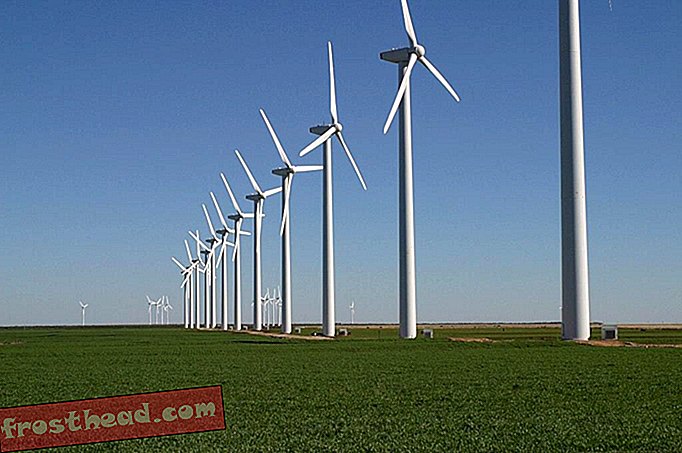Lecture de Lolita à Téhéran: un mémoire dans des livres
Azar Nafisi
Maison aléatoire
Le Téhéran où Azar Nafisi a grandi dans les années 1960 était un lieu dynamique et libérateur, grâce à la richesse pétrolière de l’Iran et au régime laïc et pro-occidental, bien qu’autoritaire, du dernier shah. Je ne connaissais la ville que comme un étranger, alors que j'y vivais au début des années 1970 en tant que journaliste.
Lorsque j’ai revu Téhéran en 1992, c’était une période difficile dans une ville sinistre, plus de dix ans après que la Révolution islamique avait remplacé le shah par un régime qui était la théocratie la plus réactionnaire de la planète. (Malheureusement, il y a eu plusieurs concurrents plus récents pour le titre.)
Ayant détruit toute opposition sérieuse, la révolution avait concentré sa répression sur la partie la plus vulnérable de la société: les femmes. L'âge légal du mariage avait été abaissé de 18 à 9 ans; la lapidation à mort était devenue la punition appropriée pour l'adultère et la prostitution. La législation draconienne exigeait que les femmes s'enserrent dans des tchadors et il leur était interdit de porter des couleurs vives ou de montrer le moindre bout de peau. Les patrouilles parcouraient les rues à la recherche de coupables et, lorsqu'elles les trouvaient, emmenaient les femmes en prison.
Dans Reading Lolita à Téhéran, Nafisi décrit la lutte des femmes iraniennes pour leur survie mentale et morale dans cette terrible terre en friche. Pour le petit cercle d’étudiantes sélectionnées avec qui, de 1995 à 1997, elle s’est rencontré tous les jeudis dans sa maison, où elle vivait avec son mari architecte et ses deux enfants, de la littérature - les œuvres de Nabokov et Fitzgerald, Henry James et Jane Austen— formé une sorte de jardin secret dans lequel ils se sont échappés au-delà du contrôle des mollahs. Dans la fiction, les étudiants étaient libres de méditer sur leur individualité et leur féminité.
"Cette pièce, pour nous tous, est devenue un lieu de transgression", écrit Nafisi, formé aux États-Unis et rentré en Iran pour enseigner aux débuts de la révolution. "Quel pays des merveilles! Assis autour de la grande table basse couverte de bouquets de fleurs, nous avons évolué dans les romans que nous avons lus."
Nafisi avait été licenciée de son poste d'enseignante à l'Université de Téhéran pour avoir refusé de porter le voile. Elle a ensuite construit une carrière d'écrivaine et de chargée de cours à temps partiel dans un petit collège local. Les élèves rencontrés chez elle ont des personnalités et des antécédents très divers. Deux avaient été emprisonnés; la plupart avaient connu des camarades étudiants, des membres de leur famille ou des amis qui avaient été torturés, assassinés ou violés par des gangsters islamistes. Tous avaient peur. "Presque chacun d'entre nous avait eu au moins un cauchemar sous une forme ou une autre dans lequel nous avions oublié de porter notre voile ou ne l'avions pas porté, et toujours dans ces rêves le rêveur courait, s'enfuyait", écrit Nafisi.
Son approche consistait à formuler certaines questions à l'intention de ses étudiants, en se concentrant sur la manière dont de grands travaux de l'imagination pouvaient aider à atténuer leur angoisse. Nafisi construit son histoire autour de l'exploration de tels livres par le groupe, notamment Lolita, The Great Gatsby et Pride and Prejudice . Tandis qu'elle dirige cette exégèse inspirée, Nafisi (qui est retournée aux États-Unis en 1997 et enseigne maintenant à la School of Advanced International Studies de JohnsHopkinsUniversity à Washington) révèle la vie de ses élèves, ainsi que la sienne, relatant finalement le drame de la répression et la survie en Iran au cours des 25 dernières années.
Mais ce n’est pas seulement un livre sur l’Iran et le pouvoir du fanatisme de ruiner la vie de gens honnêtes. En fin de compte, le thème de Nafisi est le pouvoir rédempteur de l'imagination humaine.