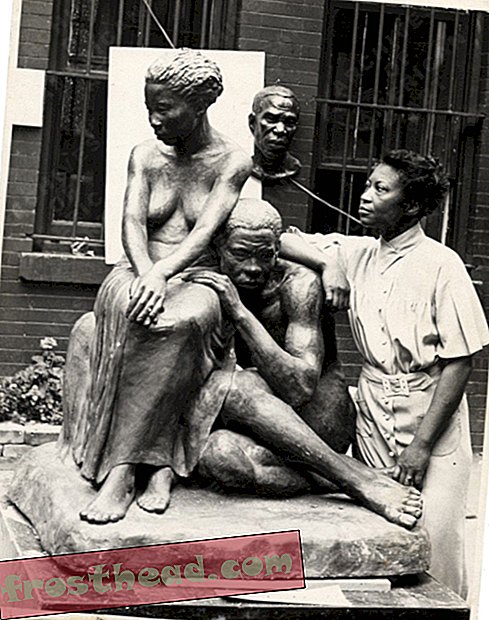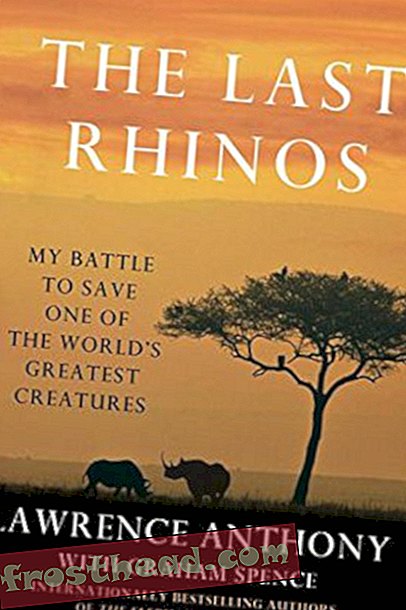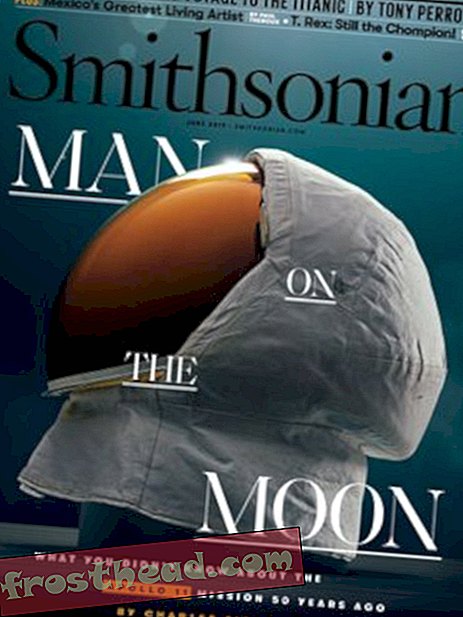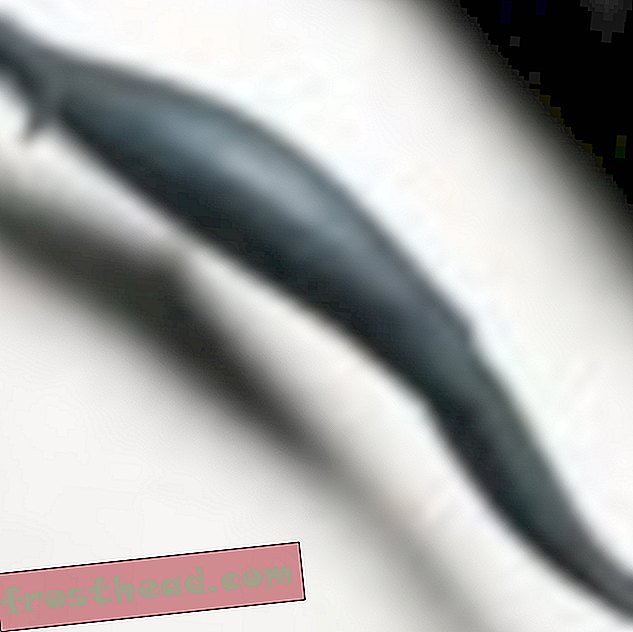Tout comme les humains, les chimpanzés ont des traditions locales. Les communautés voisines de chimpanzés en Ouganda, par exemple, dépendent de différents outils pour extraire le miel de grumes tombées; certains utilisent des bâtons, tandis que d'autres utilisent des feuilles mâchées pour éponger les friandises. Les scientifiques ont observé une foule d’autres comportements qu’ils considéraient comme «culturels», ce qui signifie que ces comportements sont spécifiques à la population et acquis par le biais de l’apprentissage social: casser des noix, utiliser des outils pour pêcher les algues ou les termites, déchirer brusquement les feuilles des branches, jeter des pierres chez les prédateurs ou les intrus. Mais comme le rapporte Michael Marshall pour New Scientist, une étude récente a révélé que face à l’empiétement humain, la culture du chimpanzé est en train de disparaître.
Selon leur étude publiée dans Science, les chercheurs ont suivi 31 comportements de chimpanzés dans 144 communautés distinctes . Le gros des données a été tiré de la littérature existante, mais 46 communautés ont été observées par le programme panafricain, qui étudie la diversité comportementale des populations de chimpanzés. Pour éviter de déranger les animaux, les chercheurs les ont suivis de loin - via des caméras, en recherchant des outils lors d'enquêtes de «reconnaissance» et en cherchant dans le caca des chimpanzés des traces d'aliments pouvant être obtenus uniquement à l'aide d'outils. L'équipe a également mesuré les influences humaines, telles que les infrastructures, la densité de population et la réduction de la couverture forestière.
Les résultats de l'étude ont été frappants. La chercheuse a découvert que les chimpanzés vivant dans des zones à «fort impact humain» étaient 88% moins susceptibles d'afficher l'un des 31 comportements que les chimpanzés résidant dans des régions au plus faible impact humain. «Même si nous avons divisé les données, nous avons eu le même schéma très évident», explique Ammie Kalan, co-auteur de l'étude et primatologue à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive, à Ed Yong, de l' Atlantique .
Cela suggère à son tour que les perturbations causées par l'homme qui affectent les chimpanzés et leurs habitats - des facteurs tels que le braconnage, l'exploitation forestière, l'exploitation minière et la construction de routes - interfèrent également avec l'apprentissage social des chimpanzés. Dans leur étude, les chercheurs ont exposé un certain nombre de raisons pour lesquelles cela pourrait être le cas. D'une part, les humains provoquent un déclin annuel de 2 à 6% des populations de grands singes, et dans certaines communautés, il se peut qu'il ne reste plus assez d'individus pour transmettre les traditions culturelles. Il est également possible que les chimpanzés suppriment délibérément certains comportements pour éviter toute détection lorsque les humains se rapprochent.
Le changement climatique pourrait également jouer un rôle; Par exemple, étant donné que les fluctuations météorologiques influent sur la disponibilité des noix, les chercheurs risquent moins de voir des chimpanzés se fissurer. Mais "très probablement", écrivent les chercheurs, "une combinaison de ces mécanismes interagit avec la stabilité de l'environnement, la démographie et la connectivité des populations, pour créer la perte globale de diversité comportementale des chimpanzés associée à l'impact humain".
Au niveau immédiat, il importe que les chimpanzés perdent leur culture, car certains comportements culturels, tels que la fissuration des noix et la pêche aux termites, aident les animaux à se nourrir.
Viennent ensuite les traditions plus mystérieuses, mal comprises mais qui semblent jouer un rôle important dans la socialisation des chimpanzés. En 2016, par exemple, Kalan et ses collègues ont révélé que certains chimpanzés en Afrique de l'Ouest jettent à plusieurs reprises des pierres sur les mêmes arbres. La raison pour laquelle ils agissent de la sorte n’est pas claire, mais les chercheurs pensent qu’ils pourraient marquer des limites territoriales dans un «rituel symbolique».
"Nous enquêtons toujours", dit Kalan à Yong. "Et nous pourrions manquer de temps."
Pour protéger les chimpanzés et mieux comprendre leurs sociétés complexes, une «approche plus intégrative de la conservation est nécessaire», écrivent les auteurs de l'étude. Les chercheurs recommandent de désigner des «sites du patrimoine culturel des chimpanzés» ou des zones protégées liées à des comportements spécifiques. Et cette approche pourrait profiter à d'autres animaux, comme les baleines et les orangs-outans, qui ont leurs propres ensembles de pratiques culturelles. En d’autres termes, explique Kalar à Sarah Sloat d’ Inverse, les défenseurs de l’environnement doivent non seulement penser à préserver le nombre et la diversité génétique des espèces, mais également leurs cultures uniques, avant qu’il ne soit trop tard.