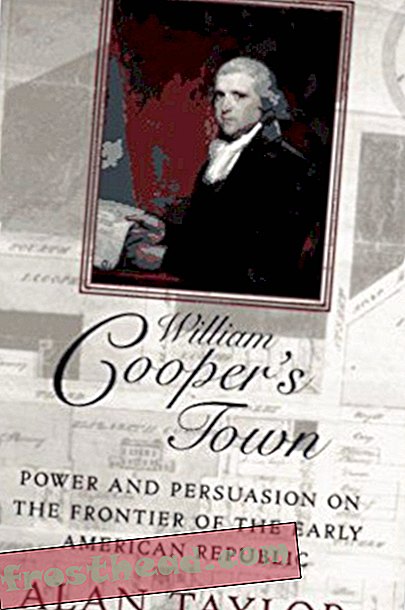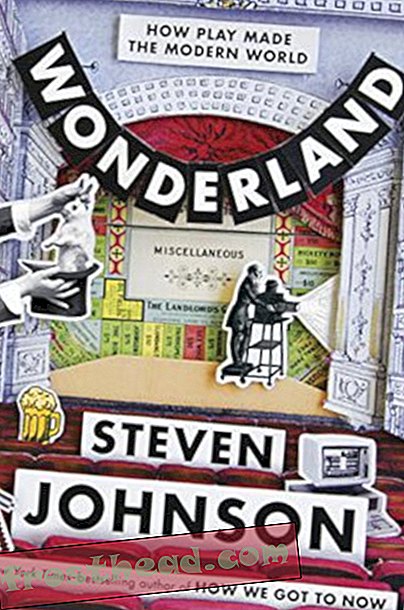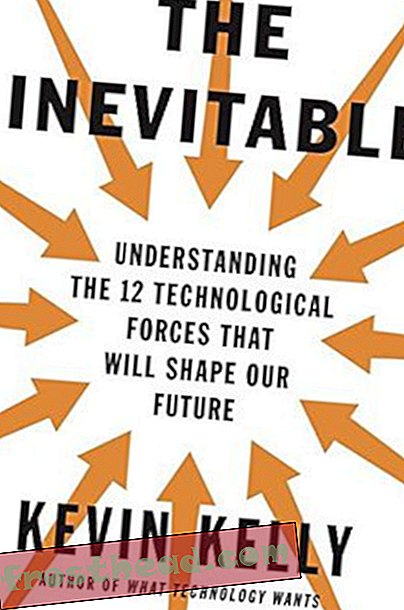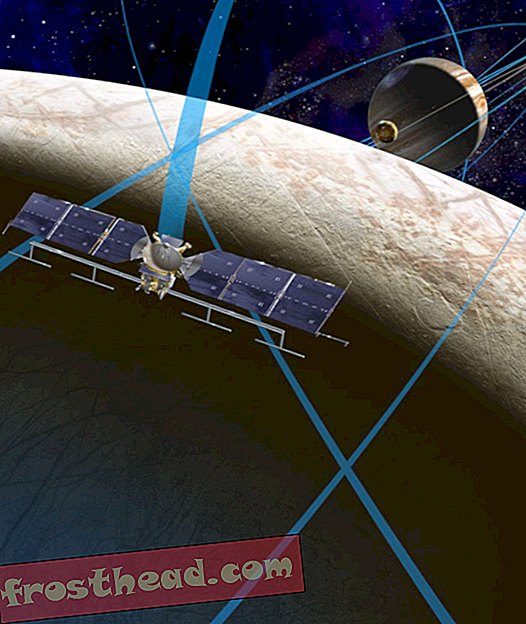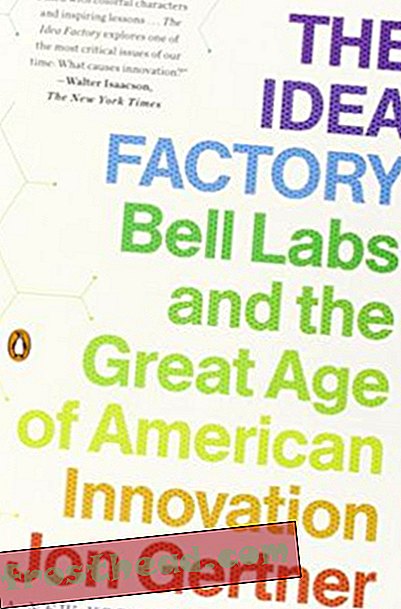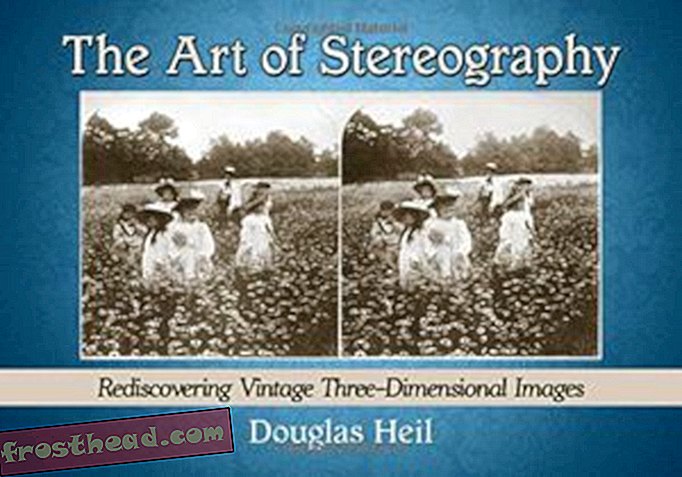Contenu connexe
- Démêler l'histoire génétique d'un peuple des Premières Nations
- Quand les scientifiques "découvrent" ce que les peuples autochtones savent depuis des siècles
- Ces grenouilles de race captive font face à des prédateurs et au champignon chytride pour se rendre à l'état sauvage
- Pourquoi voyons-nous plus d'espèces dans les forêts tropicales? Le mystère peut enfin être résolu
- Mots-clés de la science et des langues autochtones Pueden Aliarse Para Proteger Los Bosques y el Clima
- San People of South Africa publie un code de déontologie pour les chercheurs
- La forêt vierge amazon supposément vierge et intacte a été façonnée par les humains
- Le meilleur moyen de protéger les forêts du monde? Garder les gens en eux
C'était encore le matin lorsque Javier Mateo-Vega est arrivé à la salle de réunion du village d'Ipeti, au Panama, en février dernier. Mais l'air était déjà chaud et lourd, et l'ambiance était tendue.
Les citadins indigènes Emberas profitaient de l'arrivée tardive de Mateo-Vega pour exprimer leurs griefs. Un homme à l'arrière s'est plaint des nouvelles maisons construites par le gouvernement - des cabanes en béton stériles au toit de zinc qui détruisaient rapidement les huttes traditionnelles en bois de palmiers et de chaume de la ville. D'autres maudissaient les colonos - des agriculteurs et des éleveurs non autochtones qui envahissaient les terres de la communauté en provenance d'autres régions du Panama. Les chefs de village ont eu du mal à maintenir l'ordre.
Mateo-Vega, un écologiste du Tropical Research Institute du Smithsonian, s'inquiétait beaucoup. Les conflits étaient pires que ce qu'il n'avait jamais vu ici. Alors qu'il rejoignait le rassemblement, quelques hommes semblaient bouger inconfortablement ou détourner le regard, chose étrange dans un village où il travaillait depuis près de dix ans et où il était habitué à un accueil plus chaleureux. «Vous voyez une communauté se défaire», m'a-t-il dit.
Les habitants d'Ipeti (prononcé ee-pet-TEE) étaient à la croisée des chemins. Les Emberas vivent depuis longtemps dans les forêts de l'est du Panama. Ils connaissent ces forêts à l'intérieur et à l'extérieur: ils s'y promènent, y chassent et y pêchent; ils récoltent des fruits et des noix; ils ont coupé des arbres pour le bois de chauffage et les matériaux de construction. Mais depuis qu’un groupe d’Emberá a migré vers l’ouest et a fondé Ipeti il ya quelques décennies, ils sont aux prises avec des menaces extérieures qui pèsent sur leurs moyens de subsistance basés sur la forêt.
Maintenant, ils se trouvaient face à une question existentielle: resteraient-ils fidèles à leurs traditions ou se dirigeraient-ils à toute vitesse vers la modernité?
Mateo-Vega espérait aider les villageois à changer les choses. Il avait conduit trois heures à l'est de la ville de Panama pour animer un atelier de planification de l'utilisation des sols pour cette communauté de 700 personnes. Il savait que l'atelier ne résoudrait pas tous les problèmes des citadins. Mais il pensait pouvoir les aider de manière concrète: en leur fournissant les données dont ils avaient besoin pour prendre des décisions stratégiques afin de protéger leurs forêts dans les décennies à venir.
Sur le papier, les travaux visaient à conserver les forêts tropicales, bastions essentiels mais de plus en plus vulnérables dans la lutte contre le changement climatique mondial. Mais Mateo-Vega et ses collègues ont également espéré que cela ferait aussi une chose sans doute tout aussi importante: donner aux communautés autochtones la possibilité de prendre en charge leur avenir environnemental et même de revendiquer leur identité en tant que peuples des forêts.
«Imaginez que nous sommes en 2055 et que vous êtes dans un avion survolant votre territoire», a-t-il déclaré en prenant la parole devant un groupe d'environ 50 membres de la communauté. Des femmes vêtues de jupes traditionnelles aux couleurs vives étaient assises sur des chaises pliantes d’un côté du pavillon; Les hommes vêtus de jeans, de t-shirts et de casquettes de baseball s'assoyaient ou se tenaient autour de l'autre. "Que verrais-tu?"
Pas de réponse. Cela n’était pas totalement surprenant: les citadins se disputaient depuis deux heures et il faisait chaud. De plus, face à des problèmes plus immédiats, 2055 se sentait abstrait et lointain.
Derrière Mateo-Vega, les dirigeants de la communauté ont préparé deux grandes cartes qu’il avait apportées, sur la base des données fournies par les membres de la communauté lors d’un atelier l’été précédent. L'une d'elles décrit un avenir dystopique dans lequel les forêts d'Ipeti sont presque toutes défrichées pour les terres agricoles. L'autre a rendu les perspectives plus claires, dans lesquelles la communauté a pu ramener la forêt.
«C'est ton rêve», dit-il en désignant la deuxième carte.
Toujours rien. Mateo-Vega arpentait le sol de béton avec ses sandales Teva, son pantalon de sport kaki, son polo violet et son badge d'identification Smithsonian. Même après des années de travail ici, il était un outsider évident: un costaricien grand, musclé, à la peau claire et aux cheveux courts et lisses.
Il a essayé une tactique différente: "Que sont les Embera sans leurs forêts?"
Pendant quelques secondes, la foule était étrangement silencieuse. Puis un jeune homme a crié: «Rien! Sans nos forêts, nous ne sommes pas Embera!
Le visage de Mateo-Vega se détendit. Maintenant, ils commençaient à faire des progrès.
 À Ipeti, Panama, Sara Omi (à gauche), Cándido Mezúa (au centre) et Mateo-Vega explorent les perspectives d’avenir des forêts d’empbera. (Gabriel Popkin)
À Ipeti, Panama, Sara Omi (à gauche), Cándido Mezúa (au centre) et Mateo-Vega explorent les perspectives d’avenir des forêts d’empbera. (Gabriel Popkin) Dire que l'histoire des scientifiques travaillant dans les territoires autochtones est lourde serait un euphémisme. Parcourez la littérature et découvrez des histoires de chercheurs établissant leurs propres agendas, collectant et publiant des données sans consentement, et omettant d'inclure des membres de la communauté en tant que collaborateurs ou coauteurs d'études.
"Le discours dominant est que les peuples autochtones ne sont pas des penseurs", a déclaré Kim TallBear, anthropologue à l'Université de l'Alberta, qui a étudié les relations scientifiques-autochtones.
Dans le contexte de cette histoire troublée, le travail de Mateo-Vega pourrait être le début d'un contre-récit. En 2008, il a commencé à travailler à Ipeti en tant que directeur d'un projet visant à renforcer les capacités de restauration des forêts des communautés. En 2012, il s'est joint au groupe de recherche de Catherine Potvin, écologiste à la Smithsonian Institution et à l'Université McGill de Montréal, qui a ouvert la voie à une recherche plus collaborative avec le groupe Emberá.
Au fil des ans, Mateo-Vega a déclaré que lui et les habitants d'Ipeti avaient fini par se considérer comme une famille adoptive. Alors qu'il se promène dans la rue principale de la ville, les villageois lui donnent des câlins et des hauts-fives, et montrent des animaux en bois sculptés à la main et des paniers tissés à la main. Ils posent des questions sur sa femme, un Américain avec qui il vit à Panama et son fils âgé de 12 ans, qui vit au Costa Rica. «Je viendrais ici même si je ne faisais pas de recherche», dit Mateo-Vega.
De telles relations ont jeté les bases d'une collaboration avec les Emberá plus longue et plus profonde que presque tous les autres partenariats scientifiques-communautés autochtones du monde. En retour, Mateo-Vega a obtenu un accès sans précédent aux forêts presque non étudiées - et, peut-être plus important encore, aux Embera eux-mêmes. Ils lui ont ouvert leur maison, ont médité avec les anciens de la communauté et ont aidé à concevoir et à mener à bien des projets de recherche complexes.
"Vous devez rompre le pain avec eux, parcourir leurs forêts avec eux, rester chez eux, jouer avec leurs enfants et assister à leurs funérailles", dit-il. "Si vous n'aimez pas faire ce genre de choses, vous n'allez pas bien faire ici.
Mateo-Vega veut changer la façon dont la science est faite, mais il espère aussi en faire plus. Son objectif est d'aider à amener les communautés autochtones à prendre part à une conversation sur le changement climatique qu'elles ont principalement vue des marges. Alors que les gouvernements, les organisations de protection de la nature et les communautés autochtones du monde entier luttent pour la protection des forêts et la lutte contre le changement climatique, Mateo-Vega espère créer un modèle puissant à suivre par les autres.
 Femmes Emberas lors d'une réunion sur l'aménagement du territoire dirigée par Mateo-Vega en février. (Gabriel Popkin)
Femmes Emberas lors d'une réunion sur l'aménagement du territoire dirigée par Mateo-Vega en février. (Gabriel Popkin) L'histoire commence au milieu des années 90, lorsque Potvin, conseiller de Mateo-Vega, s'est aventuré pour la première fois au Darién. Elle avait entendu dire que la région isolée et sans route de Darién, dans l'extrême est du Panama - la patrie des Emberas, où vit la plupart des quelque 30 000 membres du groupe - entretenait une forêt biologiquement spectaculaire et elle souhaitait la voir par elle-même. Pour s'y rendre, il fallait un vol de Panama City et 14 heures en pirogue.
«Tu es très fatigué à la fin. Tu as vraiment mal aux fesses », dit-elle.
Finalement, elle arriva dans un petit village de huttes au toit de chaume. Les villageois parlaient encore la langue emberá et maintenaient les pratiques traditionnelles, notamment en se parant de la tête aux pieds avec de la peinture à base de fruit indigène appelé jagua . Potvin sut immédiatement qu'elle voulait travailler avec elle. Mais plutôt que d’établir son propre programme de recherche, elle a décidé de demander aux chefs de la communauté quels projets de recherche les aideraient.
«Ces gens sont extrêmement intelligents», dit Potvin, qui est petit, aux cheveux blonds et au teint clair, et dont l’anglais est fortement infléchi par un accent canadien français. "Ils n'ont pas besoin de moi pour leur dire quoi faire."
Elle a appris que la communauté comptait sur le chunga, un palmier épineux dont les villageois ont tissé des paniers. À mesure que les paniers devenaient de plus en plus populaires auprès des touristes, la surexploitation commençait à épuiser les chunga de la forêt. Pour aider les communautés à apprendre à cultiver elles-mêmes les palmiers, Potvin a fait appel à Rogelio Cansari, un Emberá du Darién qui avait obtenu un diplôme en anthropologie de l’Université Texas A & M, en tant qu’étudiant diplômé.
La paire a recueilli des graines des quelques plantes de chunga restantes qu’elle a pu trouver, les a plantées dans des parcelles expérimentales et a déterminé dans quelles conditions elles poussaient le mieux. Ensuite, ils ont travaillé avec les membres de la communauté pour établir des plantations afin d’approvisionner leur commerce en panier croissant.
De manière cruciale, ils ont également inclus des leaders autochtones en tant que coauteurs d'articles scientifiques. «Catherine est venue avec l'idée très novatrice de donner aux peuples autochtones la possibilité de faire partie des connaissances scientifiques», a déclaré Cansari, qui prépare actuellement un doctorat en anthropologie à l'Université de Copenhague. «Cela a été très utile pour mon peuple.» Les chercheurs ont traduit leurs articles en espagnol et les ont présentés lors de réunions communautaires afin que les villageois aient accès aux données et apprennent ce qui a été publié à leur sujet dans la littérature scientifique.
Bien qu'elle ne connaisse pas particulièrement le travail de Potvin, TallBear affirme que l'approche de l'écologiste va au-delà de ce que même la plupart des scientifiques désireux de collaborer sont disposés à faire. «Ce n'est pas une chose facile à faire. Cela prend du temps et cela ralentit votre temps de publication », dit-elle. «La plupart des gens qui se font passer pour des recherches en collaboration ne vont pas aussi loin.»
 Huttes traditionnelles au toit de chaume et vêtements de séchage dans une communauté Emberá du Darién. (Gracieuseté de Javier Mateo-Vega)
Huttes traditionnelles au toit de chaume et vêtements de séchage dans une communauté Emberá du Darién. (Gracieuseté de Javier Mateo-Vega) Pendant son séjour à Darién, Potvin a appris qu'un certain Embera avait émigré de la région et s'était installé à Ipeti. Intriguée, elle a elle-même visité la ville en 1996. Elle a découvert une communauté qui perpétue certaines traditions, comme vivre dans des maisons au toit de chaume, mais qui s’intégrait également dans la société panaméenne traditionnelle. La peinture sur corps et la musique traditionnelles avaient pratiquement disparu et l'espagnol remplaçait la langue emberá.
Ce n'est pas tous les jours qu'un scientifique d'une prestigieuse université s'est rendu à Ipeti, qui se trouvait alors à sept heures de route de Panama City sur une route en grande partie non pavée. Quand Bonarge Pacheco - un chef d'Emberá et d'Ipeti à l'époque - a appris que Potvin était en ville, il a mis ses plus beaux vêtements et l'a accompagnée pour le dîner.
Malgré des expériences antérieures avec des scientifiques qui avaient collecté des données dans Ipeti mais n’avaient jamais obtenu de résultats, Bonarge affirme qu’il a été conquis par Potvin. «J'ai perçu qu'elle était une personne sincère et j'avais entendu parler de son travail ailleurs», dit-il. Ils ont parlé jusqu'à minuit et le lendemain, ils avaient prévu de collaborer.
De nombreuses forêts entourant Ipeti ont été défrichées à la fois par les villageois et les colonos envahisseurs et sont en mauvais état. Les villageois avaient du mal à trouver non seulement le chunga, mais aussi plusieurs types de palmiers nécessaires pour continuer à construire leurs maisons traditionnelles: des structures rondes à côtés ouverts avec des planchers perméables à l'air et des toits de chaume qui restent froids, même sous la chaleur accablante du Panama. En conséquence, les membres de la communauté ont commencé à construire de nouvelles maisons en utilisant des matériaux non traditionnels tels que des planches de bois et de la tôle.
Potvin a travaillé avec la communauté pour étudier et cultiver quatre espèces de palmiers: chunga, wagara, giwa et sabal . Ce travail a porté ses fruits: grâce à la croissance des palmiers et à la fourniture de matériaux, Ipeti a pu poursuivre la construction de maisons traditionnelles. L'étude a également eu des effets d'une plus grande portée. Les villageois ont recommencé à jouer de la musique emberá - qui repose sur des flûtes en bambou que Potvin a également aidé à grandir - et à faire revivre leur importante tradition culturelle de la peinture sur corps.
Potvin s'est même fait peindre. Au cours de ses années de collaboration avec les Emberá, elle a déclaré avoir le sentiment de l'avoir méritée. "Je sais maintenant qu'il y a beaucoup de discours sur la réappropriation de ces choses, et c'est assez controversé", dit-elle. "Je trouve juste que c'est beau."
 Catherine Potvin, à droite, montre une carte du carbone à Evelio Jiménez et aux membres de la communauté de la comarca Guna de Madungandi, dans l'est du Panama, en 2013.
Catherine Potvin, à droite, montre une carte du carbone à Evelio Jiménez et aux membres de la communauté de la comarca Guna de Madungandi, dans l'est du Panama, en 2013. À cette époque, des politiciens et des environnementalistes de haut niveau ont commencé à s'intéresser aux forêts tropicales comme le Darién dans le cadre des efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. Lors de la conférence des Nations Unies sur le climat tenue à Montréal en 2005, un programme visant à réduire les émissions de carbone résultant de la combustion ou du défrichement des forêts en hauteur, est à l'origine de 10 à 15% des émissions de gaz à effet de serre. Le programme a été baptisé sous l'acronyme REDD, qui signifie «réduire les émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts».
L'idée de base est simple: les arbres sont composés à moitié de carbone en masse et les arbres en croissance dévorent et stockent le dioxyde de carbone, le gaz responsable de la plupart des changements climatiques causés par l'homme. Pour inciter les pays à conserver leurs forêts, les négociateurs du climat ont imaginé un marché du carbone permettant aux pays riches responsables de la plupart des émissions de carbone de payer les pays pauvres pour protéger leurs forêts. Bien que personne ne pensait qu'un tel système pourrait empêcher le changement climatique, cela semblait être une bonne stratégie pour au moins le ralentir.
Obtenir REDD + (le «+» a été ajouté en 2007 pour inclure une gestion améliorée des forêts) pour travailler sur le terrain, cependant, était tout sauf simple. Les forêts tropicales se développent dans des dizaines de pays majoritairement pauvres, dont les gouvernements manquent souvent de la volonté ou de la capacité de les protéger contre la myriade de menaces auxquelles ils sont confrontés: exploitation forestière illégale, exploitation minière, élevage de bétail, agriculture, etc. Une analyse largement citée de 2013 des données satellitaires collectées entre 2000 et 2012 a révélé que les zones forestières ont diminué dans presque tous les pays tropicaux, à l'exception du Brésil, souvent par des quantités incroyablement importantes.
En outre, peu de gouvernements des pays en développement sont en mesure de procéder aux mesures systématiques nécessaires pour vérifier que du carbone supplémentaire est réellement piégé. «La REDD + est souvent présentée comme une réussite climatique, en partie parce que l'idée semble si simple et attrayante», ont écrit l'économiste Arild Angelsen et le biologiste Louis Verchot du Centre pour la recherche forestière internationale en Indonésie en 2015. Mais hors du Brésil, «il y a peu d’histoires de progrès substantiels au début ", ont écrit les auteurs.
Ensuite, il y a le fait que les communautés autochtones ont souvent des relations difficiles avec leurs gouvernements nationaux et ont rarement été incluses dans les discussions où les mécanismes de REDD + ont été développés. En conséquence, ils se méfient des systèmes axés sur le carbone qui pourraient limiter ce qu’ils peuvent faire dans leurs forêts.
Cela commence peut-être à changer. Lors de la conférence des Nations Unies sur le climat à Paris en 2015, une coalition de groupes autochtones et de scientifiques a publié un rapport soulignant que plus d'un cinquième du carbone de la forêt tropicale dans le monde se trouve dans les territoires autochtones et appelant à un renforcement des droits fonciers et à l'inclusion des peuples autochtones dans le climat. négociations. Les recherches soutiennent cet argument: une étude récente publiée dans les Actes de la National Academy of Sciences a montré que la reconnaissance des droits des peuples autochtones en Amazonie péruvienne a contribué à la protection des forêts.
Mais il est rare que des groupes autochtones soient reconnus ou indemnisés pour la protection de leurs forêts. L'accord de Paris de 2015 mentionne les peuples autochtones à plusieurs endroits, mais ne leur garantit pas un rôle dans les plans d'action climat des pays.
«Les gouvernements sont comme des distributeurs automatiques de billets cliquer, cliquer, cliquer, cliquer, ils voient ce fonds vert comme une excellente source de nouveau financement», a déclaré Cándido Mezúa, dirigeant du groupe Emberá du Darién et coauteur du rapport 2015. «Pour vraiment protéger les forêts, le seul moyen est de reconnaître les droits des habitants de ces forêts et de titrer nos terres.»
 Les forêts d'Ipeti. (Gabriel Popkin)
Les forêts d'Ipeti. (Gabriel Popkin) Aujourd'hui, Potvin et Mateo-Vega voient dans leurs travaux une étude de cas sur la manière dont la science pourrait soutenir le type de protection envisagé par Mezúa. Selon une analyse du groupe de Potvin, plus de la moitié des forêts primaires du pays se trouvent sur des territoires autochtones. Mais avant les pourparlers de l'ONU, ils n'avaient jamais eu de raison de penser à la quantité de carbone contenue dans leurs forêts. Comme le dit Cansari: «Le carbone n'est pas quelque chose que les peuples autochtones peuvent toucher."
Potvin, qui a participé aux négociations sur le climat en tant que négociateur pour le Panama, a informé ses contacts avec Emberá des discussions sur le marché du carbone. Craignant d'être laissés de côté, les dirigeants de la communauté lui ont demandé de les aider à mesurer la quantité de carbone contenue dans leurs forêts. Elle a accepté. En commençant à Ipeti, elle a formé les membres de la communauté à enregistrer le diamètre des arbres dans les forêts gérées par la communauté, les parcelles agroforestières (plantations d'arbres produisant des fruits et des matériaux) et les pâturages de vaches. Ils ont ensuite utilisé des équations normalisées et des méthodes statistiques pour convertir les données de chaque arbre en estimations du carbone stocké dans une zone donnée.
Ils ont constaté que les forêts d'Ipeti contenaient environ deux fois plus de carbone par zone que les parcelles agroforestières, alors que les pâturages, sans surprise, contenaient peu de carbone. Etant la première à quantifier le carbone stocké dans la forêt d’Ipeti, cette étude a fourni à la communauté une base essentielle pour explorer les moyens de s’impliquer sur le marché émergent du carbone.
L’attention portée par l’étude aux forêts restantes d’Ipeti a été tout aussi importante, dit Pacheco. Selon les chercheurs, au même rythme que les habitants d'Ipeti et de son colonos abattaient des arbres, la moitié de la forêt restante aurait disparu. Les membres de la communauté ont pris note et ont considérablement ralenti le rythme de défrichage des forêts pour l'agriculture. En conséquence, environ la moitié de leur territoire est encore boisé - contrairement à Piriati, une communauté Emberá voisine où Potvin ne travaillait pas et qui a finalement perdu toute sa forêt.
«Nous appelons cela l'effet Potvin», déclare Pacheco.
 Mateo-Vega se dresse au pied d'un cuipo dans les forêts d'Ipeti. (Gabriel Popkin)
Mateo-Vega se dresse au pied d'un cuipo dans les forêts d'Ipeti. (Gabriel Popkin) Quelques années plus tard, les dirigeants de Potvin, Mateo-Vega et Emberá ont commencé à planifier une campagne de mesure du carbone forestier dans le Darién, avec le soutien du Fonds de défense de l'environnement et de la Banque mondiale. Les défis seraient beaucoup plus grands qu’à Ipeti - les équipes sur le terrain auraient besoin de marcher à pied ou en canoë pour des séjours de plusieurs semaines, et elles auraient besoin de protection contre la guérilla en Colombie voisine, qui menaçait de traverser la frontière. La confiance mutuelle que Potvin et Mateo-Vega avaient passée des années à bâtir serait essentielle.
Mateo-Vega a embauché une assistante d'Embera, Lupita Omi, qu'il connaissait depuis son séjour à Ipeti, pour organiser des réunions avec les chefs de village. (Les deux sont devenus si proches qu'ils s'appellent maintenant hermanito et hermanita - en espagnol pour «petit frère» et «petite sœur».) Lors de 38 réunions séparées, les deux partenaires ont expliqué les objectifs de leur projet et comment les données collectées seraient utiles aux communautés. Les délibérations pourraient durer jusqu'à cinq heures, car les membres de la communauté se méfiaient de toute initiative comportant même un soupçon de REDD +.
«Les communautés ont vraiment écouté attentivement chaque mot», dit Omi. «Ils ont compris que cela pourrait affecter leurs moyens de subsistance et leurs territoires.» À la fin, chaque communauté a accepté le projet.
Mateo-Vega a ensuite embauché et formé une équipe de techniciens forestiers de Darién et Ipeti, avant de plonger dans la forêt. Ils ont installé leur camp, envoyé des chasseurs après le singe ou l'iguane pour le dîner de la nuit, et se sont mis au travail en jalonnant des parcelles carrées de 100 mètres (un peu plus longues qu'un terrain de football) sur un côté et en mesurant la hauteur et la circonférence de chaque arbre supérieur à 50 centimètres de diamètre.
Le travail était pénible. La chaleur pouvait être brutale et les pluies diluviennes de la saison transformaient le sol forestier en boue. Les sentiers devaient être coupés à l'aide de machettes dans le sous-étage dense, les vipères des fosses se cachaient partout et les épines désagréables qui poussent sur de nombreuses plantes pouvaient facilement perforer les bottes et la peau. La menace de la violence n'était jamais loin des pensées de l'équipe, bien qu'elle n'ait jamais été attaquée. Lors d'une sortie, un canot transportant des membres de l'équipe de sécurité et leurs munitions ont chaviré dans un rapide et ils ont dû abandonner le voyage, même si cela impliquait de ne pas mesurer deux types de forêts lointaines.
Mais Mateo-Vega et son équipe ont eu accès à des forêts que pratiquement aucun scientifique n'avait encore étudiées. Ils ont découvert un arbre qui a brisé le record du plus grand panama. Les mesures de l'équipage ont révélé que certaines de ses forêts étaient beaucoup plus riches en carbone et regorgeaient de diversité biologique que tout le monde l'avait documentée.
Mateo-Vega en est venu à croire que Darién, un explorateur du 19ème siècle sous-estimé, l'a décrit comme un «enfer vert» - mérite d'être classé parmi les grandes régions forestières du monde. «À notre avis, c'est l'Amazonie d'Amérique centrale», dit-il. Le dernier jour de son dernier voyage sur le terrain, il a vu un jaguar nager sur une rivière - une première pour lui depuis 35 ans qu'il travaillait dans la forêt tropicale. Il rêve toujours de revenir.
En plus de collecter des données précieuses, l'équipe de Mateo-Vega a démontré un point plus important: des membres de la communauté ayant reçu une formation adéquate mais ne possédant aucune connaissance scientifique préalable pourraient prendre des mesures de la forêt aussi bien que des scientifiques. Et ils pourraient le faire à une fraction du coût. Des expériences similaires de collaborations menées ailleurs suggèrent que la REDD + pourrait être largement mise en œuvre et contrôlée directement par les communautés qui possèdent une grande partie des forêts du monde.
«Une fois formés et motivés… ils peuvent collecter des données de haute qualité comme tout le monde», explique Wayne Walker, écologiste au centre de recherche Woods Hole, qui a dirigé un projet de mesure du carbone à base communautaire en Amazonie.
Potvin a publié des lignes directrices pour une telle recherche collaborative sur le site Web de McGill. D'autres indices suggèrent également que la science pourrait perdre son héritage colonial. En mars, les San de l'Afrique du Sud ont publié ce qui est considéré comme le premier code d'éthique de la recherche élaboré par les populations autochtones d'Afrique. Les membres des Premières nations du Canada et les aborigènes d'Australie ont élaboré des codes similaires.
Mateo-Vega et ses collaborateurs ont récemment ajouté leur propre contribution à cette littérature grandissante en publiant leurs méthodes et leurs résultats dans la revue Ecosphere. Les communautés Emberá sont maintenant prêtes à collecter des données pour soutenir la REDD + ou tout autre système de compensation du carbone futur, ont-ils écrit.
«Nous nous sommes trouvés sans emploi, ce qui était prévu», explique Mateo-Vega.
…
Armées de données, les communautés emberá ont entrepris de déterminer la prochaine étape: comment l'utiliser. À Ipeti et à Piriati, qui n'ont reçu officiellement le titre de propriété que sur leurs terres en 2015, le consensus consistait en une série d'ateliers sur la planification de l'utilisation des terres pour cartographier l'incidence des décisions d'utilisation des terres sur leurs forêts.
Les ateliers ont été un "réveil" pour les communautés, dit Mateo-Vega. Il se souvient qu'un ancien de Piriati avait pleuré en réalisant que ses filles n'avaient jamais vu la forêt ni mangé de viande de gibier - le gibier indigène que les Emberas chassaient traditionnellement. "Ils se rendent compte qu'ils sont en retard", dit-il.
De retour à la réunion sur l'utilisation des terres à Ipeti, alors que Mateo-Vega continuait à expliquer les données visualisées sur ses cartes, son public avait commencé à s'ouvrir. Les membres de la communauté réfléchissaient à ce qu'ils avaient perdu avec la disparition de la forêt. «Avant, nous mangions du pécari et du cerf», a déclaré un homme. "Maintenant, nous devons avoir des gardes du parc."
Un autre a déploré le fait qu'ils mangeaient du tilapia, plutôt que du poisson wacuco indigène qui prospérait dans les cours d'eau protégés par des forêts. «Je suis Embera; Je veux vivre comme un Embera », a-t-il déclaré.
À la fin de la réunion, les membres de la communauté étaient d’accord: ils devaient ramener la forêt. Mais étant donné que l’agriculture génère souvent des profits plus rapides et très nécessaires, il reste à déterminer exactement comment ils le feraient.
Après la dispersion de la foule, Mateo-Vega s'est blotti avec les chefs de la communauté. Ils envisageaient un concept qu'ils ont appelé Emberá-REDD. Ils envisageraient de participer au programme des Nations Unies, mais à leurs propres conditions, pas à ceux préparés à Panama City ou à Washington, DC
Les jeunes pourraient être employés pour mesurer le carbone et patrouiller le territoire pour s'assurer que les colonos ne détruisent pas leurs forêts, a suggéré un dirigeant. La REDD + ne concernerait donc pas uniquement les arbres et le carbone, mais aussi les emplois et l'éducation, la sécurité alimentaire et la préservation de la culture.
«Nous devons protéger les forêts pour nos propres raisons», a déclaré Mezúa.
La forêt reviendrait. Les communautés reviendraient à manger de la viande de brousse et à cueillir des plantes médicinales. Ils reconstruiraient leurs maisons traditionnelles.
Qu'en est-il des maisons laides construites par le gouvernement, demanda Mateo-Vega.
«Peut-être qu'ils seront utilisés pour le stockage», a déclaré Sara Omi, sœur de Lupita et responsable du congrès régional d'Emberá.
Mateo-Vega a aimé ce qu'il a entendu. Mais Potvin et lui s'empressent d'insister sur le fait que leur travail n'est pas de choisir si les communautés acceptent ou non de finir REDD +, ni de prendre une autre décision à leur place. Il s’agit plutôt de donner aux communautés les moyens de faire leurs propres choix en toute connaissance de cause.
Ils reconnaissent que ce n'est pas toujours le moyen le plus facile, le plus rapide ou le plus glamour de faire de la science. Mais c'est la bonne façon. «C'est un partenariat et une relation d'égalité», dit Potvin. "Je pense à cela comme une décolonisation."