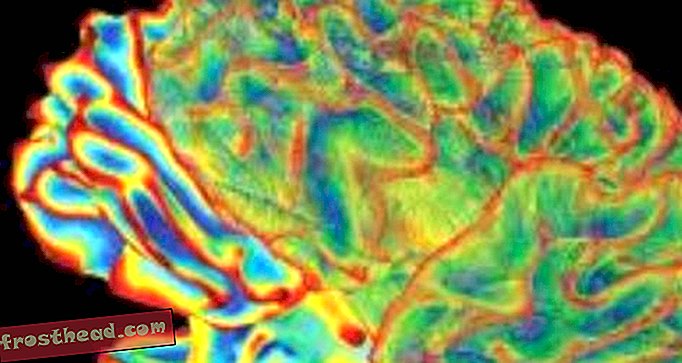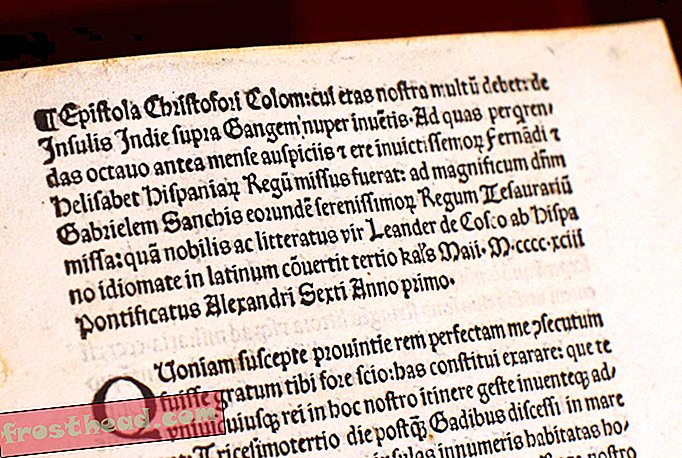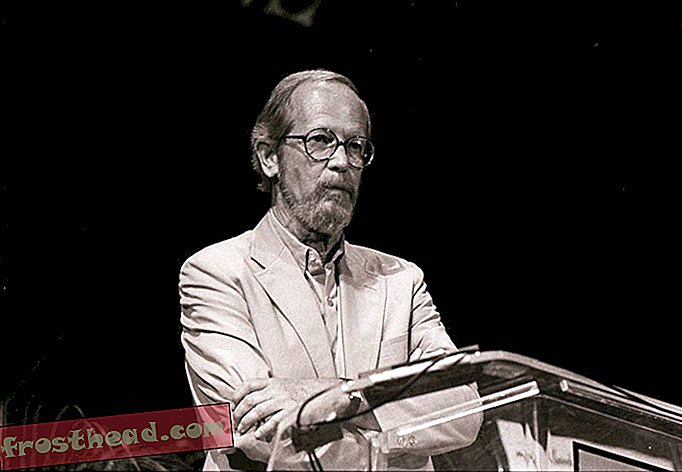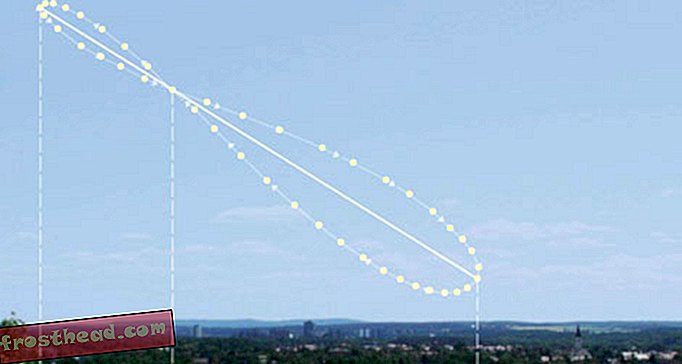Mon père, un noir de livre assez âgé pour être mon grand-père, a grandi au Texas alors que c'était encore un État ségrégué. Dès qu'il a pu, il s'est assez éloigné de là pour couvrir les murs de son bureau avec des photographies de ses voyages vers des destinations aussi exotiques que la Pologne et le Mali. Aussi loin que je me souvienne, il a insisté sur le fait que le seul endroit dans le monde qui vaut vraiment la peine d’être visité est Paris. Étant un enfant, j’ai accepté l’affirmation telle quelle - principalement à cause de la façon dont ses yeux s’illuminaient quand il parlait de cette ville qui n’était que deux syllabes pour moi - j’imaginais qu’il devait y avoir vécu une fois ou avoir été très proche de quelqu'un qui avait. Mais il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Plus tard, quand j’ai été plus grand, et quand il a eu fini d’enseigner, il enfilait souvent un sweat-shirt gris de la Sorbonne de l’Université de Paris avec un lettrage bleu foncé, un cadeau de son plus cher étudiant, qui y avait étudié à l’étranger. De mon père, j’ai donc grandi avec l’idée que la capitale de la France était moins un lieu physique qu’une idée vivifiante qui défendait bien des choses, dont l’émerveillement, la sophistication et même la liberté. «Mon fils, tu dois aller à Paris», me disait-il, sorti de nulle part, un sourire se dessinant à cette pensée, et je roulais des yeux parce que j’avais alors des aspirations personnelles, qui n’avaient que rarement lieu au-delà des nôtres. petite ville du New Jersey. «Tu vas voir», disait-il, et rigoler.

Cet article est une sélection de notre nouveau Smithsonian Journeys Travel Quarterly
AcheterEt il avait raison. Ma femme, une parisienne de deuxième génération originaire de Montparnasse, et moi-même avons déménagé de Brooklyn dans un quartier en pente douce du 9ème arrondissement, juste en dessous de la lueur néon de Pigalle, en 2011. C'était ma deuxième fois en France et pleinement consciente de l’attraction exercée par cette ville au cours des années, non seulement sur mon père, mais aussi sur le cœur et l’esprit de tant de Noirs américains. L’une des premières choses que j’ai remarquées dans notre appartement a été que, du salon donnant sur l’est, si je jetais les fenêtres et donnais sur la place Gustave Toudouze, je pouvais voir le 3 rue Clauzel, où Chez Haynes, une institution de restauration Jusque récemment, le plus ancien restaurant américain de Paris, servait du gombo à la crevette, du fatback et du chou vert à la Nouvelle-Orléans à six décennies de visiteurs lumineux, d'expatriés noirs et de curieux habitants. J'éprouve un sentiment de nostalgie si j'imaginais qu'il n'y a pas si longtemps, si j'avais louché assez fort, j'aurais repéré Louis Armstrong, Count Basie ou même un jeune James Baldwin — peut-être avec le manuscrit de Another Country sous son bras. - se faufiler à travers l’extérieur étrange de la cabane en rondins de Haynes pour s’enrichir de bavardages familiers et du goût lardé de la maison.
À bien des égards, la trajectoire de Chez Haynes, qui a finalement été bouclée en 2009, reflète le récit le plus connu de la tradition des noirs expatriés à Paris. Cela commence au cours de la Seconde Guerre mondiale, lorsque Leroy «Roughhouse» Haynes, un homme costaud de Morehouse et ancien joueur de football, comme beaucoup d’Afro-Américains initialement stationnés en Allemagne, s’est rendu dans la ville lumière une fois les combats terminés. Là, il a trouvé la liberté d'aimer qui il voulait et s'est marié avec une Française nommée Gabrielle Lecarbonnier. En 1949, ils ouvrent Gabby et Haynes, rue Manuel. Bien qu'il dira plus tard aux journalistes que «les nourritures et la nourriture des âmes» étaient difficiles à vendre pour les Français, le restaurant a immédiatement prospéré grâce aux affaires de ses amis noirs qui se débattaient dans les bars et les discothèques de Montmartre et de Pigalle - des premiers adoptants dont la présence attirait les écrivains, jazzmen et cintres. Après s'être séparé de Gabrielle, Haynes, mariée de trois ans, passa un autre séjour en Allemagne avant de rentrer à Paris et d'ouvrir son projet éponyme en solo, de l'autre côté de la rue des Martyrs, sur le site d'un ancien bordel. La centralité de ce nouvel établissement vis-à-vis de la demimonde noire de l’époque se résume en une seule image vivante: un portrait original de Beauford Delaney de James Baldwin, que Haynes a suspendu négligemment au-dessus de la porte de la cuisine.
Au moment de la mort de Leroy Haynes en 1986, la légendaire culture noire d'après-guerre que son restaurant connaissait depuis des décennies en était l'incarnation et la concentration - comme la pertinence de la musique jazz elle-même dans la vie noire - s'était en grande partie dissipée. La plupart des IG étaient rentrés chez eux depuis longtemps, alors que la législation sur les droits civils était en vigueur depuis près d'une génération. Et il n’était plus clair dans quelle mesure même les artistes regardaient encore l’Europe à la manière de l’auteur de Native Son, Richard Wright, qui avait rendu célèbre aux intervieweurs en 1946 qu’il avait «ressenti plus de liberté dans un bloc carré de Paris que dans celui-ci». Maria dos Santos, la veuve portugaise de Haynes, a fait fonctionner le restaurant - pendant quelque 23 années de plus en infusant le menu d'épices brésiliennes - il fonctionnait plus comme un mausolée que ville contemporaine. Ce que je me rappelle maintenant en poussant la poussette de ma fille devant la coquille creusée du 3 rue Clauzel en offrant un salut silencieux aux fantômes d'une génération précédente, c'est que même si j'étais arrivé plus tôt, la magie avait depuis disparu.
Ou l'avait-il? Il y a quelques années, j'ai rencontré à New York, à New York, un jeune commerçant français qui était revenu à Paris et qui avait pris l'habitude de tenir de grands dîners polyglottes avec des invités de partout, et j'ai rencontré le célèbre homme noir de la Renaissance. Saul Williams, poète, chanteur et acteur aux talents considérables. Alors que nous parlions de vin rouge et que la voix de Billie Holiday retentissait à l’arrière-plan, je me suis dit que Williams, qui vivait alors avec sa fille dans un appartement spacieux près de la gare du Nord, enregistrait de la nouvelle musique et jouait en français. le cinéma - était en fait le véritable article, une Josephine Baker ou Langston Hughes des temps modernes. L'idée me frappa aussi que, du moins ce soir-là, j'étais son témoin et faisait donc partie d'une tradition encore existante. C'était la première fois que je voyais ma propre vie à Paris dans de telles conditions.
 Joséphine Baker joue pour les troupes britanniques en permission à Paris (1er mai 1940). (Collection Hulton-Deutsch / Corbis)
Joséphine Baker joue pour les troupes britanniques en permission à Paris (1er mai 1940). (Collection Hulton-Deutsch / Corbis) Peu de temps après, Saul est retourné à New York et j'ai continué à travailler sur un roman que j'avais amené avec moi de Brooklyn - un travail solitaire qui ne donne pas beaucoup d'occasions de se mêler - mais la pensée est restée gravée dans les yeux. Paris était-il encore, de manière significative, une capitale de l'imaginaire noir américain? C'est une question à laquelle j'ai récemment décidé d'essayer de répondre. Après tout, bien qu’il y ait eu une explosion singulière de Noirs ici pendant et après les deux guerres mondiales, la romance afro-américaine avec Paris remonte encore plus loin. Cela commence dans la Louisiane, où les membres de l'élite mulâtre, souvent riches et même les propriétaires d'esclaves discriminés par la coutume du Sud, ont commencé à envoyer leurs fils francophones libres en France pour y terminer leur scolarité et vivre sur un pied d'égalité sociale. . Aussi étrange que cela puisse paraître, cette tendance se poursuit encore de nos jours avec la semi-expatriation de la superstar rappeur Kanye West, qui a planté ici plus que de simples racines riches en ressources internationales, s'est épanouie de manière créative et a fait de sérieux progrès au niveau local. industries de la musique et de la mode. (C’est l’amour non partagé de West pour tout ce qui est gaulois que nous pouvons attribuer la vision surréaliste de la campagne publicitaire de la candidate à la présidence, François Hollande, à «Niggas in Paris», à l’hymne exubérant de Ribald de Jay Z.)
Certes, une telle tradition durable, vieille de plusieurs siècles, doit encore se manifester de nombreuses façons quotidiennes que je n'avais tout simplement pas remarquées. En fait, je savais que cela était vrai lorsque, quelques mois plus tôt, j'étais devenu ami avec Mike Ladd, un artiste hip-hop de 44 ans originaire de Boston et passant par le Bronx, qui s'est également révélé être mon voisin. Comme moi, Ladd a un héritage métis mais se définit lui-même en noir; Il est également marié à un parisien et est souvent mal perçu en France. Ses yeux bleus frappants incitent les gens à le prendre pour un berbère. En discutant avec Mike, puis avec mon ami Joel Dreyfuss, ancien rédacteur en chef américano-haïtien de The Root, qui partage son temps entre New York et un appartement du 17ème arrondissement, j'ai expliqué que je cherchais la scène noire d'aujourd'hui, quelle qu'elle soit. Les deux hommes m'ont immédiatement dirigé vers le romancier et dramaturge Jake Lamar, diplômé de Harvard et habitant ici depuis 1992.
Sur des pintes de Leffe à l'hôtel Amour, une ruche d'activités sociales à la mode à seulement un pâté de maisons du vieux Chez Haynes (et également réputé dans l'espace d'un ancien bordel), Jake, à lunettes et désarmant et amical, explique qu'il a d'abord est venu à Paris en tant que jeune écrivain membre de la Lyndhurst Fellowship (un précurseur de la subvention MacArthur «Genius») et y a séjourné, comme presque tout le monde rencontré par l’étranger dans cette ville, par amour. Lui et son épouse, Dorli, acteur de théâtre suisse, ont fait leur maison d'adoption ensemble de l'autre côté de Montmartre. Bien que sa venue à Paris ne soit pas explicitement un choix contre les États-Unis, à l'instar de ceux de Wright et de Baldwin, «j'étais heureux de quitter l'Amérique», concède-t-il. «J'étais en colère à propos de Rodney King et aussi à propos de petites choses: c'est un soulagement de monter dans un ascenseur et personne ne tient son sac à main!»
Y a-t-il encore une véritable communauté noire à Paris? Je lui demande. "Les années 90 ont été un moment de communauté", explique-t-il, "mais une grande partie de l'ancienne génération est décédée." Il n'y a plus, par exemple, personne comme Tannie Stovall, la physicienne prospère dont les dîners du «premier vendredi» car les «frères» - inspirés par l’esprit de la Million Man March - sont devenus un rite de passage pour de nombreux Afro-Américains qui s’installent ou s’installent à Paris. Mais la génération d'expatriés noirs de Jake, composée principalement d'hommes dans la cinquantaine et dans la soixantaine, dont beaucoup se sont d'abord rencontrés dans l'appartement de Stovall il y a des années, perpétue la tradition du mieux qu'ils peuvent.
Une semaine après l'avoir rencontré, je me joins à Jake pour la prochaine réunion improvisée du groupe, un dîner dans un grand loft au rez-de-chaussée aux normes parisiennes de la rue du Faubourg Saint-Denis. L’animateur, un natif de Chicago nommé Norman Powell avec un authentique twang, a envoyé une invitation par courrier électronique qui semble confirmer l’évaluation de Jake: «Hé mes frères… Nos réunions du vendredi font désormais partie du passé. Ce n'est certainement pas possible pour quiconque de les accueillir comme Tannie, mais je tiens à essayer de me réunir plusieurs fois par an. »Quand j'arrive, je suis accueilli cordialement et on me dit que l'auteur et Cal me manquent Le professeur Tyler Stovall (aucun lien de parenté avec Tannie) de Berkeley, ainsi que Randy Garrett, un homme dont le nom semble faire sourire tout le monde quand on en parle. Garrett, je comprends vite, est le jokesterraconteur du groupe. Originaire de Seattle, il m'a déjà dit qu'il possédait et exploitait une articulation thoracique sensationnelle sur la rive gauche, juste à côté de la rue Mouffetard. Il passe maintenant pour un bricoleur (homme à tout faire) et pour son esprit. Dans le salon, un jeune chanteur récemment arrivé en Europe boit toujours du vin, dont le nom, que je ne décroche pas, est un expatrié de longue date nommé Zach Miller, originaire d'Akron (Ohio), marié à une française et qui dirige sa propre société de production multimédia, Richard Allen., une élégante Harlemite de presque 70 ans avec des cheveux argentés impeccablement brossés. Allen, qui confesse que son histoire d'amour avec les Français a commencé comme une rébellion personnelle contre les Espagnols qu'il a entendus toute sa vie dans le centre-ville, a avec lui un petit appareil photo compact et prend de temps en temps des photos du groupe. Il est à Paris depuis 1972, ayant notamment travaillé comme photographe de mode pour Kenzo, Givenchy et Dior.
 Le rappeur de la superstar Kanye West, vu ici lors d'un défilé de mode à Givenchy, a planté plus que de simples racines de riches personnalités internationales à Paris. (KCS Presse / Splash News / Corbis)
Le rappeur de la superstar Kanye West, vu ici lors d'un défilé de mode à Givenchy, a planté plus que de simples racines de riches personnalités internationales à Paris. (KCS Presse / Splash News / Corbis) En peu de temps, nous avons tous déménagé dans la cuisine où, alors que l'heure du dîner est déjà bien avancée, Norm nous sert gracieusement les retardataires de généreuses portions de piment et de riz, aspergées de sauce piquante et parsemées de comté au lieu de cheddar. La conversation s'éloigne des présentations aux manifestations qui font rage aux États-Unis à la suite de Ferguson et de Staten Island et, en un rien de temps, nous débattons bruyamment du déluge interminable d'allégations ravageant l'héritage de Bill Cosby. Ensuite, sur une tangente, Norm mentionne le fait qu’il a récemment découvert WorldStarHipHop.com et décrit le site Web absurde dans cette salle remplie d’expatriés. "Maintenant, le but est de faire une vidéo virale de vous-même en faisant l'imbécile", explique-t-il. «Il suffit de crier 'WorldStar!' dans la caméra. "La plupart des gars ont été hors des États-Unis depuis si longtemps, ils ne savent pas de quoi il parle. Je décris une tristement célèbre vidéo que j'ai récemment vue d'adolescents de Houston faisant la queue dans un centre commercial pour la dernière réédition d'Air Jordan, et je me rends compte tout à coup que je pleure de rire - je ris tellement, je me rends compte que je n'ai pas encore fait l'expérience à Paris avant.
Tannie Stovall n'est plus, mais s'il y a un Parisien noir centripète aujourd'hui, cette distinction doit aller à Lamar, un Chester Himes moderne et bien ajusté. Comme Himes, Jake est un adepte des formes littéraires multiples, des mémoires à la fiction littéraire, en passant par un roman policier intitulé Postérité, qui a été publié en premier comme les policiers de Himes. Mais contrairement à Himes, dont le passage en France aux côtés de Baldwin et Wright Lamar a récemment été dramatisé pour la scène dans une pièce tranchante intitulée Brothers in Exile, Lamar parle couramment cette langue. «À cet égard, je suis plus intégré dans la vie française qu'il ne l'était», précise-t-il par courrier électronique. Et c'est vrai: Jake fait partie du tissu de cette ville. Il connaît tout le monde, semble-t-il. C'est sur sa suggestion que je me trouve à une station de métro dans la banlieue de Bagnolet. Je suis ici pour rencontrer Camille Rich, une ancienne mannequin de l'agence Next et une ancienne femme brune qui vit dans une belle maison peinte en noir avec ses trois enfants du styliste afro-américain Earl Pickens. J'ai l'impression d'avoir été transporté dans une adaptation du Royal Tenenbaums. Les enfants de Camille, Cassius, 12 ans, Cain, 17 ans et Calyn, 21 ans, se révèlent immédiatement anormalement doués, excentriques et autonomes. Pendant que Calyn prépare un brunch de tarte aux courgettes, de soupe et d’œufs brouillés, j’apprends que Cassius, ventriloque autodidacte, en plus d’être le président de la classe de son école et bilingue en français et en anglais, s’amuse bien en allemand et en arabe . Pendant ce temps, Cain, qui ambitionne d’être animateur chez Pixar, peint dans sa chambre une toile complexe. Il me sourit chaleureusement, s'excusant d'être si distrait, puis continue de travailler. Calyn, pour sa part, en plus d’être une cuisinière solide et un programmeur informatique amateur, est une illustratrice hautement qualifiée et déjà publiée, dotée d’un sens de l’humour tordu et nuancé.
Après le déjeuner, je rejoins Camille au coin du feu et regarde Rocksand, la tortue ouest-africaine de la famille âgée de 14 ans, glisser sa carapace préhistorique sur le sol. Elle allume une cigarette et lance «The Bottle» de Gil Scott-Heron, expliquant que Paris a toujours occupé une place importante dans la mythologie de la famille. Son père - un mathématicien de l'Université du Temple - et son oncle sont venus en tant que GI et ont continué à jouer du jazz et à faire la fête à Pigalle. Camille, grande et belle avec des lunettes et un afro, a grandi à Philadelphie, où, à côté de ses racines noires plus traditionnelles, elle retrace son ascendance aux créoles melungeon des Appalaches. «J'ai toujours été tellement occupée par les enfants», explique-t-elle quand je pose des questions sur la communauté ici, «que je n'ai jamais vraiment eu le temps de faire autre chose.» Mais à sa connaissance, il n'y a pas d'autres familles entièrement afro-américaines comme la sienne avec des enfants nés dans le pays vivant toujours à Paris. C'est une expérience de liberté que ses enfants n'auraient pas pu vivre aux États-Unis. «Il est impossible pour un enfant américain de grandir sans l'idée de la race comme élément central de son identité», dit-elle, alors qu'à Paris, il semble souvent qu'ils aient été épargnés par cette camisole de force.
Le sous-texte de cette conversation, bien sûr, dont nous devons tous deux être conscients, est également l'une des grandes ironies de vivre en France en tant que Noir américain: Cette extension traditionnelle de la dignité humaine aux expatriés noirs n'est pas la fonction d'une équité magique. et le manque de racisme inhérent au peuple français. Cela découle en grande partie des faits corrélés de l'anti-américanisme français général, qui se présente souvent comme un réflexe contrariant consistant à faire fi des normes américaines brutales, ainsi que de la tendance à rencontrer des Noirs américains - par opposition à leurs Leurs homologues africains et caribéens - d’abord et avant tout en tant qu’américains et non en tant que noirs Ceci peut bien sûr poser ses propres problèmes à la psyché (comme l'attestent les essais bouleversants de James Baldwin), plaçant l'Afro-Américain à Paris dans une position inhabituellement nouvelle consistant à témoigner - et à échapper - aux mauvais traitements systémiques d'autres castes inférieures de la ville.
Au-delà de cela, le fait que les Noirs américains découverts à Paris au fil des ans aient tendance à être des créatifs, des alliés naturels du français sophistiqué et épris d'art, n'a jamais fait de mal. Jake Lamar m'a dit le mieux: «Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles, explique-t-il, mais le plus important est le respect des Français pour les artistes en général et les écrivains en particulier. En Amérique, on ne s'intéresse qu'aux écrivains riches et célèbres, alors qu'en France, peu importe que l'on soit un auteur à succès ou non. La vocation de l'écriture en soi est respectée. »Et c'est donc cette vénération par défaut - à son tour, étendue aux GI et à ceux qui traînaient, barbotant dans le jazz ou la cuisine soul -, qui a beaucoup contribué à isoler les Noirs américains les réalités sociopolitiques plus sévères auxquelles la plupart des groupes d'immigrants doivent faire face. Mais rien de tout cela n’est ce que je dis à Camille et à ses merveilleux enfants ce soir-là. Ce que je leur dis, avant de partir, c'est la vérité: ils m'inspirent pour avoir plus d'enfants et les élever ici en France.
Juste avant Noël, je rencontre Mike Ladd, l'artiste hip-hop qui habite dans la rue près de chez moi. Nous allons voir le célèbre groupe de rap américain Run The Jewels se produire à La REcyclerie, une gare désaffectée dotée d’une salle de spectacles située dans la banlieue à prédominance africaine et arabe du 18ème arrondissement. Mike est un vieil ami d’El-P, la moitié blanche de Run The Jewels, et nous allons dans les coulisses pour trouver le duo en train de manger du Pringles au paprika et de boire une Oie grise et des sodas avant le spectacle. Je tombe immédiatement en conversation avec Killer Mike, le partenaire de El-P, un homme physiquement gigantesque et un parolier à la conscience militante d'Atlanta, qui a déjà assisté à une lecture de livre à la bibliothèque publique de Decatur (et m'a vigoureusement débattu du public), mais qui peut ne pas se souvenir d'avoir fait cela. En tout état de cause, nous ne pouvons pas éviter de parler d'Eric Garner, l'homme de Staten Island étranglé à mort par un officier de la NYPD qui vient d'être innocenté de tout acte répréhensible. «Nos vies ne valent pas grand-chose en Amérique», fait remarquer Killer Mike à un moment donné, avec une tristesse dans sa voix qui me surprend.
La représentation de cette nuit-là est imprégnée d'une atmosphère de protestation juste. La foule parisienne grossit et semble prête à marcher et à nager jusqu’à Ferguson, dans le Missouri, d’ici la fin. Mike Ladd et moi nous attardons et sommes rejoints au bar par quelques autres expatriés noirs, notamment Maurice «Sayyid» Greene, un rappeur au naturel d'une grande gentillesse qui faisait autrefois partie du groupe Antipop Consortium. Je demande à Ladd s'il trouve que Paris est le refuge d'un homme noir. «Je pense que la France, et le reste de l'Europe continentale encore plus, est en retard dans la compréhension de la diversité», répond-il sincèrement. «Ils étaient très doués pour célébrer la différence en petites quantités - une poignée d’expatriés américains noirs, une poignée de coloniaux - mais comme on le voit souvent, la France a du mal à comprendre comment intégrer d’autres cultures dans la leur.»
Pour Sayyid, un homme de 44 ans à la peau sombre qui mesure 17 heures et demie par semaine à suivre des cours de français intensifs dispensés par le gouvernement, le prétendu traitement préférentiel réservé aux Noirs américains s'est parfois révélé insaisissable. «Je venais d’avoir mon petit garçon», me raconte-t-il à l’époque où un groupe de flics français s’est essaimé et l’a accusé d’essayer de faire irruption dans sa propre voiture. «Il avait trois jours et j'étais à l'hôpital avec ma femme. J'ai garé ma voiture et j'ai fini par verrouiller les clés à l'intérieur. J'étais avec ma belle-mère, qui est en fait un français blanc, et j'essayais de les faire sortir. Le temps a passé, un homme blanc du quartier est venu et m'a aidé, et il a commencé à faire sombre. Le gars est parti et j'étais toujours dehors. Un policier s'est enroulé et, tout à coup, il y avait six autres policiers à moto. Ils ne croyaient pas que ma belle-mère était ce que j'ai dit qu'elle était. Elle a essayé de leur parler. Finalement, ils ont accepté ma carte d'identité et ont passé, mais ma belle-mère était comme, 'Whoa!' Sa première réaction était simplement d'obéir, mais ensuite sa seconde réaction était: 'Attends une minute, pourquoi cela se produit-il?' "
Paris est-il un refuge pour les Afro-Américains ou non? L'a-t-il jamais été? «Le Paris de notre génération n’est pas Paris; c'est Mumbai, c'est Lagos, c'est São Paulo », dit Ladd. Ce qui explique en partie la raison pour laquelle il maintient un studio d’enregistrement à Saint-Denis, la banlieue du nord dont la diversité populaire, contrairement au centre de Paris, lui rappelle pourquoi il préférait le New York à Manhattan. Selon lui, ce qui a rendu Paris si attrayante pour les artistes de tous types au début et au milieu du XXe siècle, c’est la collision de vieilles traditions avec une pensée véritablement avant-gardiste. "Cette discorde électrisante se produit maintenant dans d'autres villes", souligne-t-il. C’est quelque chose que je soupçonnais aussi au cours de mes voyages, même si je n’en suis plus aussi certain. Je ne suis pas sûr que la discorde électrifiante dont nous avons grandi parler ait disparu de Paris ou ne soit plus ressentie comme telle maintenant, car partout cela se reproduit de plus en plus. Internet, les vols bon marché, la mondialisation même de la culture noire américaine à travers la télévision, le sport et le hip-hop, avec des Africains et des Arabes nés à Paris habillés comme des rats de centre-ville du New Jersey - où que l'on se trouve, la vérité est qu'il il reste peu de secrets pour aucun de nous. Lorsque je pose la même question à Sayyid, il devient philosophique: «On ne peut vraiment être qu’à un endroit à la fois», dit-il. "Si je fais 20 pompes à New York ou 20 pompes ici, ce sont les mêmes 20 pompes."
Une semaine après le massacre de Charlie Hebdo qui a décimé le faux sentiment de sérénité et de coexistence ethnique de cette ville, Jake Lamar a organisé une sortie entre frères. Le célèbre écrivain afro-américain et francophile Ta-Nehisi Coates donne une conférence sur «The Case for Reparations», son très influent article de couverture du magazine Atlantic, à l'American Library. Richard Allen, l'expatrié acharné avec la caméra, et j'arrive en retard après un verre dans un café voisin. Nous prenons des chaises à l'arrière et trouvons Coates à mi-lecture dans une maison entièrement blanche. Dans le Q & A, un homme blanc âgé demande si, à Paris, Coates a rencontré du racisme. Coates hésite avant d'admettre qu'en effet, une femme blanche s'est déjà approchée de lui en criant: "Quelle horreur, un nègre!" Avant de lui jeter une serviette en papier sale. Personne dans l'auditoire, et encore moins l'homme qui a posé la question, ne semble savoir quoi dire, et Coates raconte avec gentillesse la rencontre à la folie évidente de cette dame et non aux rouages de la société française dans son ensemble.
(Plus tard, par courrier électronique, je lui demande s’il se considère comme faisant partie de la tradition noire. Il me dit que même s’il a délibérément cherché à ne pas se faire bousculer avec d’autres écrivains noirs à Paris, «je ne sais pas trop pourquoi J'adore Baldwin… ADORE Baldwin… [mais] on se sent claustrophobe, on ne peut plus être soi-même… Cela dit, il me semble trop que d'écrire l'expérience d'expatriation noire ici comme un simple coïncidence.")
Alors que Richard et moi-même nous retrouvons avec les autres frères et leurs épouses qui se préparent à partir, Jake invite Coates à prendre un verre avec nous, mais il fait pleuvoir des chèques. Nous sortons de la bibliothèque pour nous rendre dans la rue humide du Général Camou, puis nous rentrons sur la rive droite par le pont de l'Alma, la tour Eiffel orange brillante au-dessus de nos têtes, la Seine sous nos pieds. La ville semble étrangement revenue à la normale, à l'exception de la présence occasionnelle de policiers et de militaires armés de mitraillettes et de pancartes en noir et blanc «Je Suis Charlie» collées aux fenêtres de tous les cafés. Notre groupe est composé de Jake et Dorli; Joel Dreyfuss et sa femme, Veronica, une femme frappante aux yeux bleus, qui a une peau de coco, de Saint-Louis; Randy Garrett, le raconteur-bricoleur; le cinéaste Zach Miller; Richard Allen; et un professeur d'anglais dapper de Colombie, Bob O'Meally. Nous nous glissons dans une grande table dans un café de l'avenue George V et commandons un verre. Je comprends tout de suite ce qui rend si amusant Randy quand il achète rapidement des roses en vrac à Dorli et à Veronica du Bangladesh, colportant des fleurs à la volée.
Tout le monde semble de très bonne humeur, et je sens un instant comme si j'étais réellement dans une autre époque. Nos boissons arrivent. Nous grillons, et je demande à Richard si, en réalité, le Paris noir existe toujours. «C'est par intermittence», il hausse les épaules, buvant une gorgée de vin. "Tout dépend de qui est là et de quand." En ce moment, Bob O'Meally est là et la table semble plus remplie. Il a organisé une exposition de peintures et de collages de Romare Bearden à Reid Hall, avant-poste de l'Université Columbia près de Montparnasse. Je lui dis que je suis excité de le voir, et peut-être parce que ces hommes plus âgés me rappellent tellement de lui, mes pensées reviennent à mon père.
L’une des grandes énigmes de mon enfance est que, quand il a finalement eu la chance de venir ici au début des années 90, après une quinzaine de jours où il a battu le trottoir et vu tout ce qu’il a pu, mon père est rentré à la maison comme si de rien n’avait été fait. arrivé. J'ai attendu et j'ai attendu qu'il me remplisse d'histoires sur cette ville magique, mais je n'ai rencontré que le silence. En fait, je ne pense pas qu'il ait jamais parlé de manière euphorique de Paris. J'ai toujours pensé que cela avait quelque chose à voir avec la raison pour laquelle, dans les films les plus effrayants, le public ne devrait jamais être autorisé à regarder directement le monstre. Dans les deux cas, la réalité, si grande soit-elle, ne peut se dissoudre que devant la richesse de notre imagination - et devant la tradition que nous portons en nous.